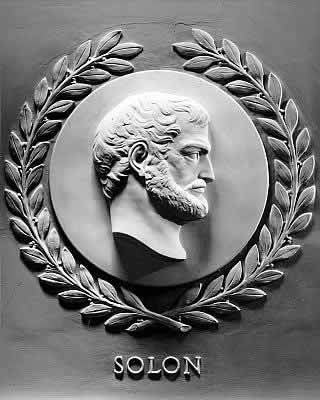
Vous trouverez l'article source en cliquant ICI.
Pour comprendre pourquoi les adversaires de la tenue d’un referendum en Grèce ont tort, un détour par le questionnement philosophique est utile. Comme il s’agit de la Grèce, ce n’est guère étonnant !
Les détracteurs de ce scrutin ont en réalité un argument principal : les Grecs sont engagés auprès de leurs partenaires et de leurs créanciers. Leur liberté s’arrête donc là où commence le respect du contrat passé avec ceux qui les ont financés et il n’y a pas de place pour le choix démocratique sur ce sujet.
Ce raisonnement renvoie très directement à la naissance de la servitude pour dettes, précisément dans l’antiquité grecque. Le système avait été formalisé par Dracon au VIIème siècle avant Jésus-Christ : un citoyen incapable de payer sa dette à son débiteur lui était asservi. Il travaillait jusqu’à remboursement, perdant de facto sa liberté et son droit de participer aux décisions de la cité. Il s’agissait principalement de paysans dits « hectémores », louant des terres affermées à de grands propriétaires.
Ne nous leurrons pas : c’est cette perspective que certains commentateurs envisagent froidement aujourd’hui pour Athènes. Jean Quatremer, par exemple, blogueur attaché au journal dit de gauche « Libération », se plaît à rappeler, dans un entretien avec l’historien Nicolas Bloudanis, que « la Grèce a été mise sous tutelle en 1897 par ses créanciers, soit principalement la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, ce qui a eu un effet positif, même si 10% de sa population a émigré. » !
Rebelote dans les années 1930 : « la tutelle de la Commission financière internationale (CFI) installée à Athènes et chargée de contrôler directement le budget de l’Etat, a permis de construire un Etat. » Et dix de der au moment du plan Marshall, quand les Américains prirent de facto le contrôle du pays. Ce curieux rappel des mérites de la domination étrangère et de la perte de la souveraineté devient carrément scabreux lorsqu’on y décèle comme une pointe de nostalgie pour les régimes dictatoriaux : « chaque fois que l’Etat a plus ou moins bien fonctionné, il s’agissait d’un Etat autoritaire où les libertés politiques et civiles étaient limitées. » A quand la réhabilitation des colonels ?
Le rejet du principe même du referendum par les partenaires/bailleurs de fonds de la Grèce s’inscrit, symétriquement, dans la dérive autoritaire du fonctionnement des institutions européennes. L’adoption, en 2007, du traité de Lisbonne qui a permis de contourner le « non » populaire au traité de Rome II symbolisait le triomphe du « cercle de la raison » contre les aberrations électives d’un peuple ignare prenant des décisions mauvaises pour son avenir, selon le point de vue de ses maîtres, bien évidemment. Pensée et dirigée par une soi-disant élite qui veut faire le bien des masses contre leur gré, la construction européenne, depuis près de soixante ans, procède par contournements techniques, textes abscons et coups de force politiques. Aujourd’hui, son visage autoritaire apparaît au grand jour.
Pour autant, est-il légitime de borner la liberté et la souveraineté grecques au respect des droits des créanciers ?
C’est dans l’histoire et la philosophie que nous trouverons la réponse à cette question. Car, au VIème siècle avant Jésus-Christ, le grand réformateur Solon, père du régime démocratique, constatant les dégâts du régime draconien, a aboli la servitude pour dettes.
L’esprit de ses lois était simple : la liberté individuelle et civique est inaliénable. Elle est le socle intangible sur lequel sont bâtis tant la démocratie que le libéralisme. Si votre créancier vous a prêté de l’argent et que vous ne pouvez le rembourser, qu’il perde ses fonds plutôt que vous ne perdiez votre liberté ! Tout prêt comporte une part de risque pour le prêteur. Il est logique que ceux qui avancent des fonds assument leurs pertes sans pouvoir saisir autre chose que des biens matériels. Et encore, à la condition qu’ils aient des hypothèques, ce qui n’est même pas le cas grec aujourd’hui. Le débiteur défaillant peut perdre des biens mais pas sa liberté.
C’est en réalité à une régression gravissime des principes fondateurs de la démocratie et du libéralisme que les adversaires du referendum grec ouvrent la voie sans trop en avoir conscience.
Soyons clairs : nous ne sommes en aucune manière sympathisant de l’incurie généralisée qui a régné à Athènes ces dernières années. Si les Grecs font faillite et sortent de l’Euro, ils devront se serrer durement la ceinture, se priver d’importations, entreprendre de construire une économie moderne, réformer leurs institutions pour les purger d’un clientélisme abject et archaïque. Mais il n’y a de toute façon pas d’autre voie : nous ne sommes plus en 1897 et une tutelle de 10 ou 20 ans sur un peuple est inenvisageable.
Solon plutôt que Dracon, Athènes plutôt que Sparte et ses Hilotes maintenus dans la servitude de générations en générations : le choix des libéraux et des démocrates est clair et il n’a pas beaucoup changé en plus de deux mille ans.
Serge Federbusch pour Atlantico
Pour comprendre pourquoi les adversaires de la tenue d’un referendum en Grèce ont tort, un détour par le questionnement philosophique est utile. Comme il s’agit de la Grèce, ce n’est guère étonnant !
Les détracteurs de ce scrutin ont en réalité un argument principal : les Grecs sont engagés auprès de leurs partenaires et de leurs créanciers. Leur liberté s’arrête donc là où commence le respect du contrat passé avec ceux qui les ont financés et il n’y a pas de place pour le choix démocratique sur ce sujet.
Ce raisonnement renvoie très directement à la naissance de la servitude pour dettes, précisément dans l’antiquité grecque. Le système avait été formalisé par Dracon au VIIème siècle avant Jésus-Christ : un citoyen incapable de payer sa dette à son débiteur lui était asservi. Il travaillait jusqu’à remboursement, perdant de facto sa liberté et son droit de participer aux décisions de la cité. Il s’agissait principalement de paysans dits « hectémores », louant des terres affermées à de grands propriétaires.
Ne nous leurrons pas : c’est cette perspective que certains commentateurs envisagent froidement aujourd’hui pour Athènes. Jean Quatremer, par exemple, blogueur attaché au journal dit de gauche « Libération », se plaît à rappeler, dans un entretien avec l’historien Nicolas Bloudanis, que « la Grèce a été mise sous tutelle en 1897 par ses créanciers, soit principalement la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, ce qui a eu un effet positif, même si 10% de sa population a émigré. » !
Rebelote dans les années 1930 : « la tutelle de la Commission financière internationale (CFI) installée à Athènes et chargée de contrôler directement le budget de l’Etat, a permis de construire un Etat. » Et dix de der au moment du plan Marshall, quand les Américains prirent de facto le contrôle du pays. Ce curieux rappel des mérites de la domination étrangère et de la perte de la souveraineté devient carrément scabreux lorsqu’on y décèle comme une pointe de nostalgie pour les régimes dictatoriaux : « chaque fois que l’Etat a plus ou moins bien fonctionné, il s’agissait d’un Etat autoritaire où les libertés politiques et civiles étaient limitées. » A quand la réhabilitation des colonels ?
Le rejet du principe même du referendum par les partenaires/bailleurs de fonds de la Grèce s’inscrit, symétriquement, dans la dérive autoritaire du fonctionnement des institutions européennes. L’adoption, en 2007, du traité de Lisbonne qui a permis de contourner le « non » populaire au traité de Rome II symbolisait le triomphe du « cercle de la raison » contre les aberrations électives d’un peuple ignare prenant des décisions mauvaises pour son avenir, selon le point de vue de ses maîtres, bien évidemment. Pensée et dirigée par une soi-disant élite qui veut faire le bien des masses contre leur gré, la construction européenne, depuis près de soixante ans, procède par contournements techniques, textes abscons et coups de force politiques. Aujourd’hui, son visage autoritaire apparaît au grand jour.
Pour autant, est-il légitime de borner la liberté et la souveraineté grecques au respect des droits des créanciers ?
C’est dans l’histoire et la philosophie que nous trouverons la réponse à cette question. Car, au VIème siècle avant Jésus-Christ, le grand réformateur Solon, père du régime démocratique, constatant les dégâts du régime draconien, a aboli la servitude pour dettes.
L’esprit de ses lois était simple : la liberté individuelle et civique est inaliénable. Elle est le socle intangible sur lequel sont bâtis tant la démocratie que le libéralisme. Si votre créancier vous a prêté de l’argent et que vous ne pouvez le rembourser, qu’il perde ses fonds plutôt que vous ne perdiez votre liberté ! Tout prêt comporte une part de risque pour le prêteur. Il est logique que ceux qui avancent des fonds assument leurs pertes sans pouvoir saisir autre chose que des biens matériels. Et encore, à la condition qu’ils aient des hypothèques, ce qui n’est même pas le cas grec aujourd’hui. Le débiteur défaillant peut perdre des biens mais pas sa liberté.
C’est en réalité à une régression gravissime des principes fondateurs de la démocratie et du libéralisme que les adversaires du referendum grec ouvrent la voie sans trop en avoir conscience.
Soyons clairs : nous ne sommes en aucune manière sympathisant de l’incurie généralisée qui a régné à Athènes ces dernières années. Si les Grecs font faillite et sortent de l’Euro, ils devront se serrer durement la ceinture, se priver d’importations, entreprendre de construire une économie moderne, réformer leurs institutions pour les purger d’un clientélisme abject et archaïque. Mais il n’y a de toute façon pas d’autre voie : nous ne sommes plus en 1897 et une tutelle de 10 ou 20 ans sur un peuple est inenvisageable.
Solon plutôt que Dracon, Athènes plutôt que Sparte et ses Hilotes maintenus dans la servitude de générations en générations : le choix des libéraux et des démocrates est clair et il n’a pas beaucoup changé en plus de deux mille ans.
Serge Federbusch pour Atlantico


